| 3 réactions chimiques et filières énergétiques
 Présentation Présentation
Nous avons déjà approché les transformations chimiques réalisées dans l'organisme pour tirer l'énergie des aliments. Dans le grand schéma qui suit, nous présentons de manière très simplifiée, le corps central de ces réactions. 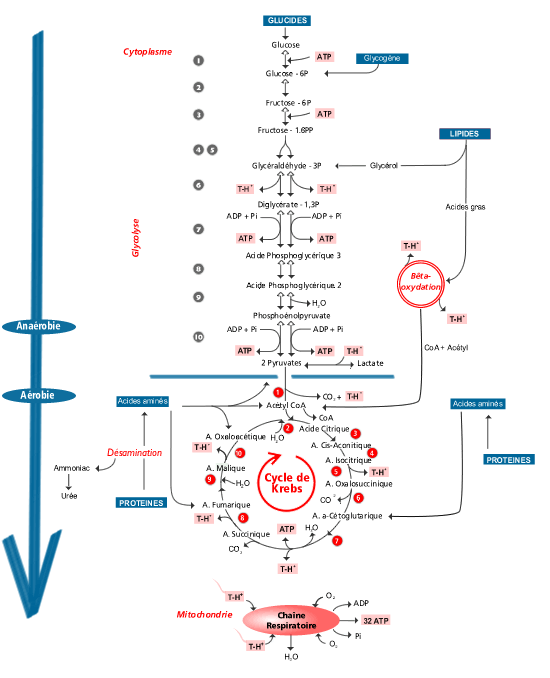
Présentation simplifiée d'une partie des transformations chimiques se déroulant au sein de l'organisme
L'important n'est pas de retenir les réactions et autres produits intermédiaires mais plus de repérer les fins atteintes et les principes utilisés.
3.1 Transformer : pour quoi ?
Les réactions chimiques tendent à profiter de l'énergie provenant de l'excitation des électrons par le soleil. Cette énergie est alors transmise à un composé phosphaté - l'adénosine tri phosphate (ATP) - qui, lui, sait la donner à son tour aux galériens du muscle.
Faisant le lien entre l'ATP et le substrat, l'hydrogène joue le rôle de vecteur énergétique (en orange sur le schéma). Il est arraché aux substrats et conduit jusqu'à un endroit appelé la chaîne respiratoire.
Et notre électron alors, où est-il ? Par l'intermédiaire d'un transporteur, il est associé à ce compère très intime qu'est le proton hydrogène. Ce n'est qu'une fois arrivé au niveau de la chaîne respiratoire, qu'il est arraché au proton. Il subit alors une suite de sauts énergétiques au cours desquels il va se vider de son énergie (Cf physiologie.
Mais diantre ! Nous sommes déjà en train de parler du "comment" des transformations.
3.2 Transformer : comment ?
Dans l'univers, l'énergie existe sous des formes plus ou moins organisées et concentrées. Comme nous l'avons déjà souligné, elle est capable de passer d'une forme à une autre. Dans le cas ou aucun apport extérieur n'interviendrait, cet échange d'énergie ne peut se faire que de la forme la plus concentrée et organisée vers la forme la plus dégradée. Nous touchons là aux deux premières lois de la thermodynamique. Des lois qui décrivent le fonctionnement de l'univers donc de nos organismes. C'est ce que nous allons découvrir à travers la métaphore qui suit. Les relations énergétiques qui se déroulent dans nos cellules peuvent être comparées à un don qu'une personne ferait à une autre. Comme un généreux donateur accepterait de faire offrande de son bien à une autre personne, les composés successifs se passent l'énergie de mains en mains.
Bien entendu, ce "marché des bienfaisances" suit des règles.
 la transaction ne peut se faire librement que dans le sens conduisant de la personne qui a le plus d'énergie vers celle qui en a le moins (2ème principe de la thermodynamique dit principe de Carnot). la transaction ne peut se faire librement que dans le sens conduisant de la personne qui a le plus d'énergie vers celle qui en a le moins (2ème principe de la thermodynamique dit principe de Carnot).
 le don suppose d'être assez important pour combler pleinement le receveur. Celui qui récupère l'énergie n'acceptera jamais d'offrande si elle est inférieure à ce que ses petits bras peuvent supporter. le don suppose d'être assez important pour combler pleinement le receveur. Celui qui récupère l'énergie n'acceptera jamais d'offrande si elle est inférieure à ce que ses petits bras peuvent supporter.
 si le don est plus important que ce que le receveur peut accueillir, le surplus déborde. Si cet excès est à son tour suffisamment grand, il est récupéré par le glaneur universel qu'est l'ATP. Dans le cas contraire, il s'envole sous forme de chaleur. si le don est plus important que ce que le receveur peut accueillir, le surplus déborde. Si cet excès est à son tour suffisamment grand, il est récupéré par le glaneur universel qu'est l'ATP. Dans le cas contraire, il s'envole sous forme de chaleur.
En moyenne, 40% de l'énergie des substrats est utilisé par l'organisme à des fins d'anabolisme (production et restauration des cellules) et de mouvement ; le reste part en chaleur. Finalement toutes les transactions chimiques permettent de libérer petit à petit, l'énergie contenue dans les aliments. Nous pouvons nous demander pourquoi il en est ainsi. Pourquoi l'organisme ne va-t-il pas au plus simple ? Pourquoi ne va-t-il pas chercher l'énergie directement où elle se trouve la plus concentrée ? Tout simplement parce que nous sommes fragiles.
Tout simplement parce qu'un petit feu de bois nous chauffe alors qu'un incendie nous brûle !
L'exemple du rayonnement nucléaire nous donne un aperçu tragique de ce qui advient lorsque l'organisme rencontre une source d'énergie trop importante (pour information, la scission en deux morceaux par un neutron d'un atome d'uranium 235 dégage une énergie un million de fois supérieure à celle produite par la réaction chimique la plus énergétique). Point de folies, la dette énergétique d'un organisme se paye "en petite monnaie d'électrons" (Laborit) ! Voilà un des principes de fonctionnement du vivant. 3.3 Des principes 3.3.1 (rétro)actions positives et négatives : la régulation
Imaginons une réaction qui transforme A en B grâce à l'intervention de l'enzyme E (une enzyme est un composé rendant possible et activant une réaction sans pour autant être modifiée par elle ; c'est un "agent de rencontre"). Et voyons comment la dynamique de cette réaction est déterminée par la quantité des substrats présents.
Plusieurs configurations peuvent se présenter :
a l'enzyme est présente en grande quantité : elle aura tendance à activer la réaction. l'enzyme est présente en grande quantité : elle aura tendance à activer la réaction.
b le produit initial A arrive en quantité importante, il accélère également la réaction. Sa transformation en B est activée. le produit initial A arrive en quantité importante, il accélère également la réaction. Sa transformation en B est activée.
c le produit final B s'accumule : cette dynamique aura tendance à exercer une rétroaction négative sur la réaction. En d'autres termes, elle "prévient" directement ou indirectement qu'elle est en quantité trop importante et qu'il convient de ralentir la cadence. le produit final B s'accumule : cette dynamique aura tendance à exercer une rétroaction négative sur la réaction. En d'autres termes, elle "prévient" directement ou indirectement qu'elle est en quantité trop importante et qu'il convient de ralentir la cadence.
Comme le produit final revient sur ce qui le crée, on parle parfois de boucles de rétroaction négative (on utilise également les termes d'instructions positives ou négatives en retour, d'inhibitions ou d'activations, de feed-back.). Ces boucles se retrouvent à tous les étages du vivant.
Parfois, la régulation provient de deux processus antagonistes qui ne sont pas liés directement. On peut alors employer le vocable de principe des contraires.
Les mots sont ennuyeux et compliqués mais l'idée est à chaque fois la même. Si nous plaçons un objet au centre et que nous tirons ensemble dans le même sens, nous additionnons nos forces et engendrons un processus puissant. Si nous tirons dans un sens opposé, nous arrivons à un équilibre par fluctuations. Il est possible qu'à un moment je tire un peu plus fort que toi et qu'au moment suivant ta force soit plus vigoureuse que la mienne. L'objet se déplace légèrement dans une direction puis dans l'autre. Il fluctue autour d'une position d'équilibre. Si maintenant, nous ajoutons des tireurs dans tous les sens, nous avons une idée des moyens utilisés par notre organisme pour réaliser cette précieuse constance du milieu intérieur (psychologie.
Le principe que nous pouvons dégager de ce fonctionnement est que le vivant est capable de s'opposer à lui-même, de s'autolimiter. Sans cette capacité à trouver une stabilité par autolimitation, nous aurions des portions du vivant qui - semblables aux cellules cancéreuses - disparaîtraient de s'être développées au point de tuer leur milieu.
La limitation de soi se retrouve dans la course. Nous voyons dans le chapitre suivant consacré aux filières énergétiques qu'à chaque pas de course nous contribuons à enrayer le pas suivant. Mais avant cela, donnons un second principe de fonctionnement. 3.3.2 complexité et durée
Selon les caractéristiques de leur structure, les substrats - lipides, protides, glucides - demandent plus ou moins de transformations pour être complètement dégradés en énergie utilisable par le muscle. Toutes ces réactions chimiques demandent du temps. Nous pouvons généraliser en disant que plus la complexité des phénomènes intervenant est grande, plus le temps nécessaire à leur mise en ouvre est important. Par ailleurs, ce temps peut être d'autant plus long que les composés nécessaires à la réaction ne sont pas présents sur place.
Ces deux caractéristiques expliquent la lenteur de la dégradation des lipides par exemple. Ce principe rend compte du fait que la dégradation des substrats avec l'air (aérobie) prend plus de temps à s'activer et à se réaliser que leur transformation anaérobie. Il éclaire la dynamique des filières énergétiques
|